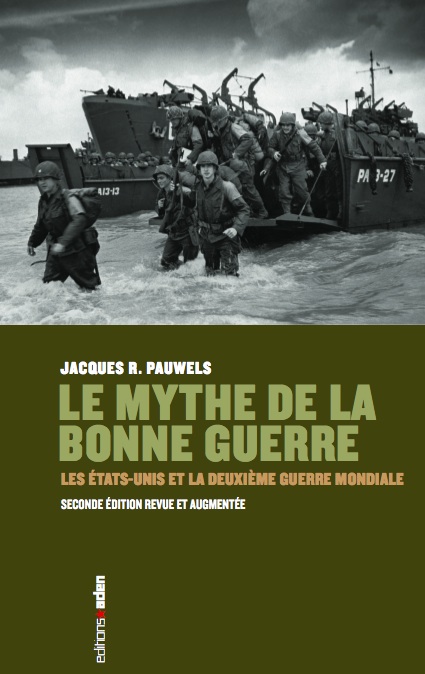
Faites un don pour nous aider à réimprimer ce livre: ici  Édition revue et augmentée
ISBN : 9782805920052
384 pages
12,5 x 20 cm
22 Euros | A nouveau disponible. 10 décembre 2017 !!!! Jacques Pauwels
LE MYTHE DE LA BONNE GUERRE
Les USA et la Seconde Guerre mondiale
Édition revue et augmentée
Â
L’irruption des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale doit-elle être considérée comme une croisade contre la barbarie nazie, la lutte du Bien contre le Mal ? Jacques Pauwels, historien canadien, brise le mythe.
À ses yeux, les Américains étaient, en effet, loin d’être inintéressés par les ressources économiques et la dimension géostratégique des régions qu’ils allaient libérer.
Ils débarquèrent donc avec une idéologie, des vues politiques, une conception des rapports sociaux à préserver et, bien entendu, avec l’idée qu’il fallait assurer les intérêt de leurs entreprises et du capitalisme américain. La crainte de l’expansion communiste et le désir d’en limiter les effets ne furent évidemment pas étrangers
à cette philosophie interventionniste.
Ce livre brise l’image d’Épinal du libérateur américain venant mourir sur les plages de Normandie dans un but uniquement philanthropique.
Une contre-histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui modifie radicalement notre vision du XXe siècle et offre un nouveau regard sur l’époque actuelle.
Jacques R. Pauwels (né à Gand, Belgique, en 1946) vit depuis 35 ans au Canada. Docteur en sciences politiques et en histoire, il a enseigné ces matières à l’Université de Toronto.
Son site Internet : www.jacquespauwels.net Le documentaire de Jacques Pauwels : http://www.marc-bielli.com/goodwar1.html Clip vidéo d'une conférence donnée sur ce livre :Â
Chapitre 17: La diplomatie de l’atome et le début de la Guerre Froide
A la suite de la capitulation de l’Allemagne au début du mois de mai 1945, la guerre en Europe était terminée. Les puissances victorieuses se trouvaient maintenant confrontées au problème complexe et délicat de la réorganisation de l’Europe d’après-guerre. En Europe de l’Ouest, les Américains et les Britanniques avaient déjà créé un nouvel ordre presqu’un an auparavant, et Staline avait accepté cet arrangement. En Europe de l’Est, le dirigeant soviétique jouissait clairement d’un avantage grâce à la présence de l’Armée Rouge. Or, à cette époque, les Alliés occidentaux pouvaient toujours espérer apporter leur contribution à la réorganisation de cette partie de l’Europe. Certes, Staline avait manœuvré dans ces pays en faveur des communistes et de leurs sympathisants, et au désavantage de tous ceux qui, à tort ou à raison, étaient suspectés d’être anti-soviétiques ou anti-communistes, mais tout était encore possible. En ce qui concerne l’Europe de l’Est, les outsiders occidentaux pouvaient espérer tirer profit des accords conclus à Yalta et de la formule churchillienne de zones d’influence. Quant à l’Allemagne, les Alliés occidentaux jouissaient même d’un léger avantage sur leur collègue du Kremlin car, suite aux accords londoniens ratifiés à Yalta, les Américains et les Britanniques occupaient ensemble la partie la plus étendue et la plus importante de l’Allemagne ainsi que la part du lion de la ville de Berlin.
En Europe de l’Ouest, tout avait déjà été décidé ; en Europe de l’Est, et en Allemagne, tout restait possible. Il était loin d’être inévitable que l’Allemagne restât divisée pour longtemps en zones d’occupation et que l’Europe de l’Est se trouvât pour un demi-siècle dans les griffes des Soviétiques. Staline, qui serait plus tard blâmé pour toutes ces choses déplaisantes, avait en réalité de bonnes raisons de se montrer accommodant en ce qui concernait l’Allemagne et l’Europe de l’Est. Il était conscient que des demandes irréalistes ou une attitude récalcitrante envers les Américains et les Britanniques impliquaient de gros risques. Comme Dresde l’avait clairement montré, une telle conduite pouvait être catastrophique pour l’Union Soviétique. De plus, Staline espérait que de la bonne volonté et de la coopération, combinées avec sa promesse de déclarer la guerre au Japon, rapporteraient de bons résultats sous la forme d’une assistance américaine dans la tâche, certaine d’être surhumaine, de la reconstruction de l’Union Soviétique dans l’après-guerre.
Motivé par un mélange de crainte et d’espoir, Staline était prêt à coopérer avec les Américains et les Britanniques mais, bien entendu, il s’attendait aussi à obtenir pour l’URSS les bénéfices qui étaient réservés aux puissances victorieuses. Par exemple, il prévoyait certains gains territoriaux (ou, si l’on veut, une compensation pour les pertes de territoires subies par l’Union Soviétique ou par la Russie tsariste qui l’avait précédée) ; de considérables réparations de la part de l’Allemagne ; la reconnaissance de son droit de ne pas avoir à tolérer des régimes anti-soviétiques dans les pays limitrophes de l’URSS ; et, non le moins important, la possibilité de continuer à bâtir une société socialiste en URSS. Ses partenaires américains et britanniques n’avaient jamais indiqué à Staline que ces revendications leur semblaient déraisonnables. Tout au contraire, la légitimité de ses buts de guerre soviétiques avait été reconnue à maintes reprises, tant explicitement qu’implicitement, à Téhéran, à Yalta et ailleurs.
Il était possible de traiter avec Staline, mais un tel dialogue nécessitait de la patience et de la compréhension pour le point de vue de l’Union Soviétique, y compris le fait que les soviétiques n’étaient pas préparés à quitter la table de conférence les mains vides. Or, Truman n’avait aucune envie de s’engager dans un tel dialogue. Il n’avait aucune compréhension même pour les moindres des revendications soviétiques, et il abhorrait l’idée que l’Union Soviétique pût recevoir des réparations pour ses sacrifices et qu’elle pût ainsi recommencer à travailler au projet d’une société communiste. Tout comme un nombre important d’autres dirigeants américains, le président espérait qu’il serait possible d’expulser les Soviétiques de l’Allemagne et de l’Europe de l’Est sans compensation et de mettre un terme à leur projet communiste, qui demeurait une source d’inspiration pour toutes sortes de radicaux partout dans le monde, même aux Etats-Unis.
Comme Churchill, Truman préférait de loin le "bâton" de la ligne dure envers Staline à la "carotte" de la ligne conciliante. Nous avons déjà vu que ceci était dû en grande partie au fait que la situation militaire des Alliés occidentaux s’était considérablement améliorée en mars et avril 1945. Cependant, c’était un avantage mineur en comparaison avec l’atout potentiellement fantastique que le président américain pouvait espérer jouer bientôt dans la partie de cartes avec Staline. Le 25 avril 1945, Truman prit connaissance du projet ultra-secret Manhattan ou S-1, comme on appelait le projet de l’arme atomique en langage codé. Les scientifiques américains avaient travaillé sur cette nouvelle arme puissante depuis des années ; maintenant elle était pratiquement prête, elle serait bientôt testée, et peu après elle pourrait être utilisée. La bombe atomique jouerait un rôle important dans le nouveau cours pris par la politique américaine durant le printemps 1945 en Europe et également en Extrême-Orient. Truman et ses conseillers se trouvaient fascinés par ce que le célèbre historien américain William Appleman Williams a appelé une "vision d’omnipotence". En effet, ils étaient entièrement convaincus que la bombe atomique leur permettrait d’imposer leur volonté à l’URSS. La bombe atomique constituait "un marteau", comme disait Truman lui-même, qu’il brandirait au-dessus de la tête de "ces gars au Kremlin".
La possession de la bombe atomique semblait ouvrir toutes sortes de perspectives auparavant impensables, et extrêmement favorables, aux champions de la ligne dure envers les Soviétiques. Grâce à la bombe, il devait désormais être possible de forcer Staline, en dépit des accords passés, de retirer l’Armée Rouge d’Allemagne et de lui refuser la parole dans les tractations concernant les arrangements d’après-guerre de ce pays. Maintenant il semblait également possible d’installer des régimes pro-occidentaux et même anti-communistes en Pologne et ailleurs en Europe de l’Est, et d’empêcher Staline d’y exercer toute influence. Il devenait même pensable que l’Union Soviétique elle-même soit ouverte tant au capital d’investissement américain qu’à l’influence politique et économique américaine,et que cet hérétique communiste retourne ainsi au sein de l’église universelle capitaliste. "L’évidence existe", écrit l’historien allemand Jost Dülffer, que Truman était convaincu que le monopole de la bombe nucléaire serait le "passe-partout pour la réalisation des idées américaines concernant un nouvel ordre mondial".
En comparaison avec la ligne conciliante de Roosevelt, qui était délicate et souvent difficile, la politique de la ligne dure - à savoir : la politique du "bâton" tout puissant que la bombe atomique promettait d’être - semblait simple, efficace et donc extrêmement attractive. S’il était resté en vie, Roosevelt lui-même aurait probablement opté pour cette politique. Son successeur, Truman, n’avait aucune expérience avec la ligne conciliante, avec la "carotte". Pour cet homme peu sophistiqué du Missouri, la simplicité et le potentiel de la nouvelle ligne dure se révélaient irrésistibles. Ainsi naquit la diplomatie de l’atome, qui a été dévoilée d’une manière si captivante par l’historien américain Gar Alperovitz.
Le monopole de la bombe atomique devait permettre à l’Amérique d’imposer sa volonté sur l’URSS. Toutefois, au moment de la capitulation allemande en mai 1945, la bombe n’était pas encore prête, mais Truman savait qu’elle le serait bientôt. Par conséquent, il ne tint pas compte de l’avis de Churchill de discuter du sort de l’Allemagne et de l’Europe de l’Est avec Staline "avant que les armées de la démocratie ne fondent", c’est-à -dire, avant que les troupes américaines ne se retirent d’Europe. Truman accepta finalement la tenue d’une rencontre au sommet entre les Trois Grands à Berlin, mais pas avant l’été, lorsque la bombe devait être prête.
A la conférence de Postdam qui dura du 17 juillet au 2 août 1945, Truman reçut le message tant attendu lui annonçant que la bombe atomique avait été testée avec succès le 16 juillet à Almagordo, au Nouveau Mexique. Le Président américain se trouvait maintenant assez fort pour prendre l’initiative. Il ne se soucia plus de présenter des propositions à Staline et, au lieu de cela, fit un tas de demandes ; simultanément il rejeta catégoriquement toutes les propositions qui émanaient du côté soviétique, par exemple, celles qui concernaient les réparations allemandes, dont les principes avaient déjà été acceptées à Yalta. Or, Staline ne montra aucun signe de faiblesse, même pas lorsque Truman essaya de l’intimider en lui soufflant dans l’oreille que l’Amérique avait acquis une nouvelle arme terrifiante. Le sphinx Soviétique, qui avait certainement déjà été informé du projet Manhattan par ses espions, écouta dans un silence de plomb. Truman en conclut que seule une démonstration réelle de la bombe atomique pouvait persuader les Soviétiques de plier. Le résultat : aucun accord sur les questions importantes ne put être atteint à Postdam.
Entre-temps, les Japonais continuaient à se battre en Extrême-Orient, même si leur situation était totalement désespérée. En fait, ils étaient prêts à capituler, mais pas de manière inconditionnelle, comme les Américains l’exigeaient. La raison: une telle capitulation pouvait entraîner l’abdication de l’Empereur Hirohito ainsi que la possibilité qu’il soit poursuivi pour crimes de guerre ; dans la culture japonaise, cela aurait été l’équivalent de l’humiliation suprême. Les dirigeants américains en étaient parfaitement conscients. Quelques-uns d’entre eux - dont le Secrétaire à la Marine, James Forrestal – pensaient, comme l’écrit Alperovitz, "qu’une déclaration réaffirmant aux Japonais que ’capitulation inconditionnelle’ ne signifiait pas automatiquement abdication de l’Empereur, conduirait probablement à la fin de la guerre". En effet, il aurait dû être possible d’amener les Japonais à capituler en dépit de leur demande d’immunité pour Hirohito. Il y avait eu le précédent de la capitulation allemande de Reims qui, comme nous l’avons vu, n’avait pas été entièrement inconditionnelle non plus. De plus, la condition posée par Tokyo était loin d’être primordiale. Plus tard, une fois la capitulation inconditionnelle arrachée aux Japonais, les Américains ne se donneront pas la peine de poursuivre Hirohito, et c’est grâce à Washington que ce dernier restât Empereur pendant de nombreuses décennies.
Pourquoi les Japonais pensaient-ils qu’ils pouvaient encore s’offrir le luxe d’inclure une condition dans leur offre de capitulation ? La raison résidait dans le fait qu’en Chine, l’essentiel de leur armée était encore intact. Ils pensaient pouvoir utiliser ces forces pour défendre le Japon et donc, de faire payer aux Américains un prix très élevé pour leur victoire pourtant inévitable. Cependant, cette stratégie ne pouvait fonctionner que si l’Union Soviétique ne s’engageait pas dans la guerre en Extrême-Orient, immobilisant du même coup les forces japonaises en Chine. En d’autres mots, la neutralité soviétique offrait à Tokyo une lueur d’espoir, non pas pour la victoire, mais pour des négociations avec les Etats-Unis et la possibilité de conditions de capitulation quelque peu plus favorables. Dans une certaine mesure, la guerre contre le Japon s’éternisait parce que l’URSS n’y était pas encore impliquée. Or, déjà en 1943 à Téhéran, Staline avait promis de déclarer la guerre au Japon trois mois après la capitulation de l’Allemagne, et il avait réitéré cet engagement le 17 juillet 1945, à Potsdam. Par conséquent, Washington s’attendait à une attaque soviétique sur le Japon au milieu du mois d’août. Les Américains ne savaient donc que trop bien que la situation du Japon était désespérée. Comme Truman l’écrivit dans son agenda en référence à l’intervention attendue des Soviétiques dans la guerre d’Extrême-Orient : "C’en sera fini avec les Japonais quand les Russes attaqueront."
De plus, la marine américaine avait assuré Washington qu’elle était en mesure d’empêcher les Japonais de rapatrier leur armée de Chine, afin de défendre leur patrie contre une invasion américaine. Finalement, il était même douteux qu’une invasion du Japon soit nécessaire. En effet, cette nation est une île, ou plutôt un archipel, autour duquel la marine des Etats-Unis pouvait simplement instaurer un blocus, et cela aurait confronté Tokyo au choix de capituler ou mourir de faim.
Afin de terminer la guerre contre le Japon sans avoir à faire des sacrifices supplémentaires, Truman disposait donc d’un nombre d’options très intéressantes. Il pouvait accepter la condition japonaise banale concernant l’immunité pour leur Empereur. Il pouvait également attendre que l’Armée Rouge attaque les Japonais en Chine, forçant ainsi Tokyo à accepter une capitulation inconditionnelle. Finalement, il pouvait instaurer un blocus naval qui aurait forcé Tokyo, tôt ou tard, à demander la paix. Or, Truman et ses conseillers ne retinrent aucune de ces options et décidèrent plutôt d’assommer le Japon avec la bombe atomique. Cette décision fatidique, qui devait coûter la vie à des centaines de milliers de personnes, présentait de considérables avantages pour les Américains. Par exemple, la bombe pouvait forcer les Japonais à capituler avant que les Soviétiques ne s’engagent dans la guerre en Asie. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de permettre à Moscou de participer aux décisions futures concernant le Japon d’après-guerre, les territoires qui avaient été occupés par le Japon (tels que la Corée et la Mandchourie), et l’Extrême-Orient et la région du Pacifique en général. De cette manière, les Etats-Unis jouiraient d’une hégémonie totale dans cette partie du monde, une hégémonie dont on peut dire qu’elle avait été le véritable but, bien qu’inavoué, de Washington dans le conflit avec le Japon.
Ce dernier point mérite un examen plus précis. Pour les Américains, une intervention soviétique dans la guerre en Extrême-Orient menaçait d’offrir à Staline le même avantage que l’intervention, relativement tardive, des Américains en Europe avait rapportée à ceux-ci, c’est-à -dire : une place à la table des puissances victorieuses qui allaient imposer leur volonté à l’ennemi battu, décider des traces des nouvelles frontières, déterminer les structures économiques et sociales et, par cela, empocher d’énormes avantages et de prestige. Or, Washington ne voulait pas du tout que l’Union Soviétique bénéficie de ces privilèges en Extrême-Orient. Les Américains avaient éliminé leur grand rival impérialiste dans cette partie du monde. Ils ne nourrissaient aucunement l’idée d’y faire face à un nouveau rival, surtout un rival dont l’idéologie communiste pourrait se révéler influent dans beaucoup de pays asiatiques.
Les dirigeants américains pensaient qu’après le viol de la Chine par les Japonais et l’humiliation par ceux-ci, des puissances coloniales traditionnelles dans la région, telles que la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas, ainsi qu’après leur propre victoire contre le Japon, la réalisation de leur rêve d’une hégémonie absolue en Extrême-Orient nécessitait seulement l’élimination de l’URSS de cette partie du monde. Ceci leur paraissait une petite formalité. Leur déception et leur amertume n’en étaient que plus grandes lorsque, après la guerre, les Soviétiques réussirent à s’assurer d’une certaine mesure d’influence en Corée du Nord, et lorsque la Chine fut "perdue" au profit des communistes de Mao. Au Vietnam, précédemment connu comme l’Indochine française, un mouvement populaire d’indépendance sous la direction de Ho Chi Min avait des plans qui se révélaient incompatibles avec les grandes ambitions asiatiques des Etats-Unis. Aucune surprise, donc, que la guerre éclaterait en Corée et au Vietnam, et qu’il y aurait de très graves tensions entre les Etats-Unis et la Chine "rouge".
Grâce à la bombe atomique, les Etats-Unis pouvaient espérer agir en Extrême-Orient en cavalier seul, c’est-à -dire sans que la fête ne soit gâchée par la présence de convives soviétiques indésirables. Mais la bombe atomique offrait un second avantage à Washington. L’expérience de Truman à Postdam avait persuadé le président américain que seule une démonstration réelle de cette nouvelle arme ferait plier Staline. Une explosion nucléaire au Japon pouvait dont être utile comme un nouveau signal pour le Kremlin, un signal qui ferait de celui qui avait été donné à Dresde, rien de plus qu’un clin d’œil.
Il était inutile que Truman utilise la bombe atomique pour mettre le Japon à genoux. Comme le Rapport des bombardements stratégiques américains le reconnaissait de manière catégorique : le Japon aurait capitulé "certainement avant le 31 décembre 1945, même si on n’avait pas utilisé les bombes atomiques, même si la Russie n’était pas entrée en guerre, et même si aucune invasion n’avait été envisagée ou planifiée." Or, Truman avait des raisons de vouloir utiliser la bombe nucléaire. Elle permettrait aux Américains de forcer Tokyo à capituler sans condition, de fermer la porte de l’Extrême-Orient aux Soviétiques et, non moins important, d’imposer la volonté de Washington au Kremlin concernant les affaires européennes. Hiroshima et Nagasaki furent pulvérisés pour ces raisons. Beaucoup d’historiens américains n’en sont que trop conscients. Sean Dennis Cashman écrit :
« Avec le passage du temps, beaucoup d’historiens ont conclu que la bombe avait été utilisée aussi pour des raisons politiques. Vannevar Bush [le chef du bureau américain de recherches et de développement scientifiques] déclara que la bombe "fut aussi employée afin d’éviter de faire des concessions à la Russie à la fin de la guerre". Le Secrétaire d’Etat James F. Byrnes n’a jamais démenti une déclaration qui lui fut attribuée, dans laquelle il déclarait que la bombe avait été utilisée pour démontrer la puissance américaine aux Soviétiques, de manière à les rendre plus dociles en Europe ».
Or, en ce temps-là , Truman lui-même déclara hypocritement que l’objectif des deux bombardements nucléaires était de "ramener les boys à la maison", en d’autres mots, de finir rapidement la guerre sans aucune perte additionnelle du côté américain. Cette explication fut diffusée sans aucune critique dans les médias américains, et devint un mythe, propagé énergiquement par la majorité des historiens américains, et encore très influent aujourd’hui.
La bombe atomique fut prête à être utilisée juste avant que l’Union Soviétique n’ait une chance de s’engager en Extrême-Orient. Pourtant, la dévastation nucléaire d’Hiroshima du 6 août 1945 vint trop tard pour empêcher les Soviétiques d’entrer dans la guerre contre le Japon, ce qui ruina, du moins partiellement, le délicat scénario de Truman. Malgré les terribles destructions endurées à Hiroshima, Tokyo n’avait pas encore capitulé lorsque le 8 août 1945 - exactement trois mois après la capitulation allemande à Berlin - l’URSS déclara la guerre au Japon. Le jour suivant, l’Armée Rouge attaqua les troupes japonaises stationnées dans le Nord de la Chine, en Mandchourie. Peu de temps auparavant, Washington avait désiré ardemment une intervention soviétique dans la guerre contre le Japon, mais lorsque durant l’été 1945 cette intervention était sur le point de se matérialiser, Truman et ses conseillers étaient loin d’être enchantés du fait que Staline allait tenir parole. Il était maintenant crucial de mettre un terme à la guerre le plus vite possible, de manière à limiter les dommages politiques causés par l’intervention de l’URSS. Tokyo ne réagit pas immédiatement au bombardement d’Hiroshima par la capitulation inconditionnelle tant espérée. Apparemment, le gouvernement japonais ne comprit pas initialement ce qui s’était passé à Hiroshima, car beaucoup de raids aériens conventionnels avaient produit des résultats catastrophiques similaires. Par exemple, l’attaque d’une centaine de bombardiers, du 9 au 10 mars 1945, sur la capitale japonaise, avait causé plus de victimes qu’à Hiroshima. Les autorités japonaises ne pouvaient pas se rendre compte qu’une telle destruction avait été provoquée par un seul avion et une seule bombe.
C’est pourquoi la capitulation inconditionnelle tant désirée par les Américains prit un certain temps. C’est ce qui permit à l’URSS de faire son entrée dans la guerre contre le Japon. Or, cela rendait Washington extrêmement impatient, et un jour après la déclaration de guerre soviétique du 9 août 1945, une seconde bombe fut lâchée, cette fois sur Nagasaki. De ce bombardement, dans lequel un grand nombre de Japonais catholiques périrent, un ancien aumônier de l’armée américaine déclara par la suite : "C’est une des raisons pour laquelle je pense qu’ils lâchèrent une seconde bombe. Pour tout accélérer. Pour les faire capituler avant que les Russes n’arrivent."
Néanmoins, il fallut encore cinq jours supplémentaires, jusqu’au 14 août, avant que les Japonais se décident à capituler. Entre-temps, l’Armée Rouge put faire de bons progrès, au grand chagrin de Truman et de ses conseillers.
Malgré tout, les Américains se trouvaient ainsi en compagnie d’un partenaire soviétique en Extrême-Orient. Toutefois, cela n’empêcha pas Truman de faire prévaloir ses idées. Le 15 août 1945 déjà , Washington rejeta la demande de Staline d’une zone d’occupation soviétique dans le pays du Soleil Levant. Et lorsque, le 2 septembre 1945, le général Mac Arthur accepta officiellement la capitulation japonaise sur un navire de guerre américain, le Missouri, dans la Baie de Tokyo, des représentants de l’Union Soviétique, ainsi que des autres Alliés en Extrême-Orient, y compris la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, furent autorisés à participer seulement comme humbles figurants. Le Japon ne fut pas divisé en zones d’occupation, comme l’Allemagne. Le rival battu des Etats-Unis allait être occupé dans son entièreté par les Américains seuls, et comme "vice-roi" américain à Tokyo, le général MacArthur s’assurerait que, quelles qu’aient pu être les contributions des autres Alliés à la victoire sur l’ennemi commun, aucune autre puissance n’aurait voix au chapitre dans les affaires du Japon de l’après-guerre.
Les conquérants américains recréèrent le pays du Soleil Levant selon leurs idées et à leur avantage. En septembre 1951, une Amérique satisfaite signa un traité de paix avec le Japon. Or, l’URSS, dont les intérêts n’avaient jamais été pris en compte, ne co-signa pas ce traité. Les Soviétiques se retirèrent de Chine, mais ils refusèrent d’évacuer certains territoires japonais tels que Sakhaline et les îles Kouriles, qui avaient été occupées par l’Armée Rouge durant les derniers jours de la guerre. Par après, ils seront critiqués pour cela sans merci par les Etats-Unis, comme si l’attitude des Américains n’avaient aucune incidence sur cette position. Durant la Guerre Froide, la déclaration de guerre soviétique au Japon sera aussi présentée comme une lâche attaque contre un pays battu, alors que Washington même avait, depuis des années, insisté auprès de Staline pour qu’il fasse le pas.
Les Etats-Unis durent leur monopole de pouvoir sur le Japon battu partiellement à la bombe atomique. En Europe toutefois, la diplomatie de l’atome de Truman allait avoir des conséquences tragiques. Le successeur de Roosevelt à la Maison Blanche avait espéré que la démonstration nucléaire allait contraindre Staline à accepter les demandes américaines concernant l’Allemagne et l’Europe de l’Est. Mais cet espoir resta sans suite. Gar Alperovitz a décrit dans les détails comment, immédiatement après les bombardements atomiques sur le Japon, c’est-à -dire au début de l’automne 1945, le dirigeant soviétique se montra suffisamment impressionné pour faire des concessions concernant les pays des Balkans tels que la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, où il autorisa la floraison d’un pluralisme politique et la tenue d’élections libres. Aux Etats-Unis, les médias notèrent ces changements et n’hésitèrent pas à les mettre au crédit, comme l’écrivait le New York Herald Tribune, de "la fermeté de Truman, soutenue par la bombe atomique". Encouragé, Truman fit toujours de nouvelles demandes, par exemple concernant la constitution des gouvernements de Sofia et de Bucarest, et révéla qu’il n’était plus intéressé dans un dialogue d’égal à égal sur la base des accords de Yalta et de Postdam, mais déterminé à éliminer toute influence de l’Union Soviétique en Europe de l’Est. Alors l’attitude de Staline se raidit, et il installa des gouvernements exclusivement communistes, et inconditionnellement pro-soviétiques, dans tous les pays occupés par l’Armée Rouge.
Staline était indubitablement désireux d’engager un dialogue équitable entre puissances co-victorieuses dans la guerre contre l’Allemagne nazie. Même plus tard, il restera intéressé par un tel dialogue, comme le reflétera son approche raisonnable des arrangements d’après-guerre concernant la Finlande et l’Autriche. L’Armée Rouge se retirera au moment opportun de ces pays sans laisser de régimes communistes derrière elle. Ce ne fut pas Staline, mais bien Truman qui, en 1945 (et par après), ne manifesta aucun intérêt pour un dialogue sur un pied d’égalité. Fort de l’arme atomique, le président américain ne sentait plus qu’il devait discuter d’égal à égal avec les "gars du Kremlin", qui ne disposaient pas d’une telle super-arme. Gabriel Kolko observe : "Les dirigeants américains déployaient une éloquence hypocrite, ils insultaient la Russie... Ils refusaient de négocier sérieusement, simplement parce qu’ils étaient sûrs que l’Amérique, maîtresse d’un pouvoir économique et militaire extraordinaire, pourrait en fin de compte définir l’ordre mondial."
Du point de vue soviétique, la diplomatie américaine de l’atome correspondait à rien moins qu’un chantage nucléaire. Bien qu’intimidé dans un premier temps, Staline refusa finalement de se soumettre à ce chantage. Par conséquent, Truman ne fut jamais capable de récolter les fruits de sa politique nucléaire. Le dirigeant soviétique comprit rapidement que des concessions en Europe de l’Est ne mèneraient à rien d’autre qu’une escalade des demandes américaines et que Washington ne serait satisfait qu’avec un retrait soviétique unilatéral de pays tels que la Pologne et la Hongrie, demande tout à fait inacceptable. Contrairement à l’orthodoxie du temps de la Guerre Froide, des retraits négociés de l’Armée Rouge des pays occupés, laissant derrière elle des structures capitalistes entièrement intactes, étaient très acceptables pour Staline, comme le cas de la Finlande le démontra clairement. Ce pays, qui s’était battu du côté allemand contre l’URSS, ne devint pas un satellite soviétique parce que, comme l’intellectuel finnois Jussi Hanhimäki l’a souligné, un accord fut négocié par lequel les Soviétiques obtinrent ce qu’ils voulaient, à savoir : "la sécurité de leur frontière Nord-Ouest, et une garantie que le pays [la Finlande] ne soit plus jamais utilisé comme base pour "une attaque contre l’URSS". Quant aux Américains, Hanhimäki ajoute : "ceux-ci croyaient que s’ils devenaient trop agressifs en Finlande, ils ne feraient qu’inviter [les Soviétiques à procéder à ] l’inclusion de la Finlande dans les rangs des démocraties populaires." Le cas de la Finlande démontre qu’il n’était pas impossible de négocier avec Staline. En ce qui concerne la Pologne et le reste de l’Europe de l’Est, le gouvernement de Truman – plus que confiant grâce au pistolet nucléaire à sa ceinture - se montra trop agressif et refusa aux Soviétiques la sécurité qu’ils recherchaient. Ce faisant, les Américains "invitèrent" en effet les Soviétiques à inclure la Pologne dans les rangs des satellites de l’URSS.
Après que les stratèges soviétiques eurent digéré les leçons d’Hiroshima et de Nagasaki, ils refusèrent, tout comme certains analystes à l’Ouest, de croire qu’une guerre puisse être gagnée seulement par les airs, même en utilisant des bombes atomiques. Staline en conclut que la meilleure défense contre la menace nucléaire consistait à faire en sorte que l’Armée Rouge reste déployée aussi près que possible des lignes américaines dans les pays libérés ou/et occupés d’Europe Centrale et de l’Est. Dans ces conditions, les bombardiers américains auraient à affronter un très long voyage avant de pouvoir lâcher leurs bombes en Union Soviétique ; en outre, en attaquant les lignes de l’Armée Rouge, ils auraient inévitablement mis leurs propres troupes en péril. Cela signifia que l’Armée Rouge se retrancha le long de la ligne de démarcation entre les zones d’occupation des Alliés occidentaux et la leur. En 1944 et en 1945, Staline avait instauré peu ou pas de changements politiques ou socio-économiques dans les pays libérés ou occupés par l’Armée Rouge, y compris la Hongrie, la Roumanie et la zone d’occupation soviétique en Allemagne, et il y avait même toléré certaines activités anti-soviétiques et anti-communistes. (Par exemple: en Roumanie, durant l’été 1945, une agitation anti-soviétique dirigée par le roi Michel et autres dirigeants politiques avait été tolérée par Moscou.) Tout cela changea très vite sous la pression de la diplomatie de l’atome américaine. Des régimes communistes et inconditionnellement pro-soviétiques furent installés partout, et la moindre opposition n’était désormais plus acceptée. Seulement à ce moment, c’est-à -dire à la fin de 1945, un "rideau de fer" descendit entre Stettin, sur la Mer Baltique, et Trieste, sur l’Adriatique. Cette expression fut utilisée pour la première fois par Churchill le 5 mars 1946 dans un discours à Fulton, une ville de l’état natal de Truman. Cela était approprié car, sans la politique de l’atome lancée par Truman, l’Europe n’aurait probablement jamais été divisée par un rideau de fer.
|
